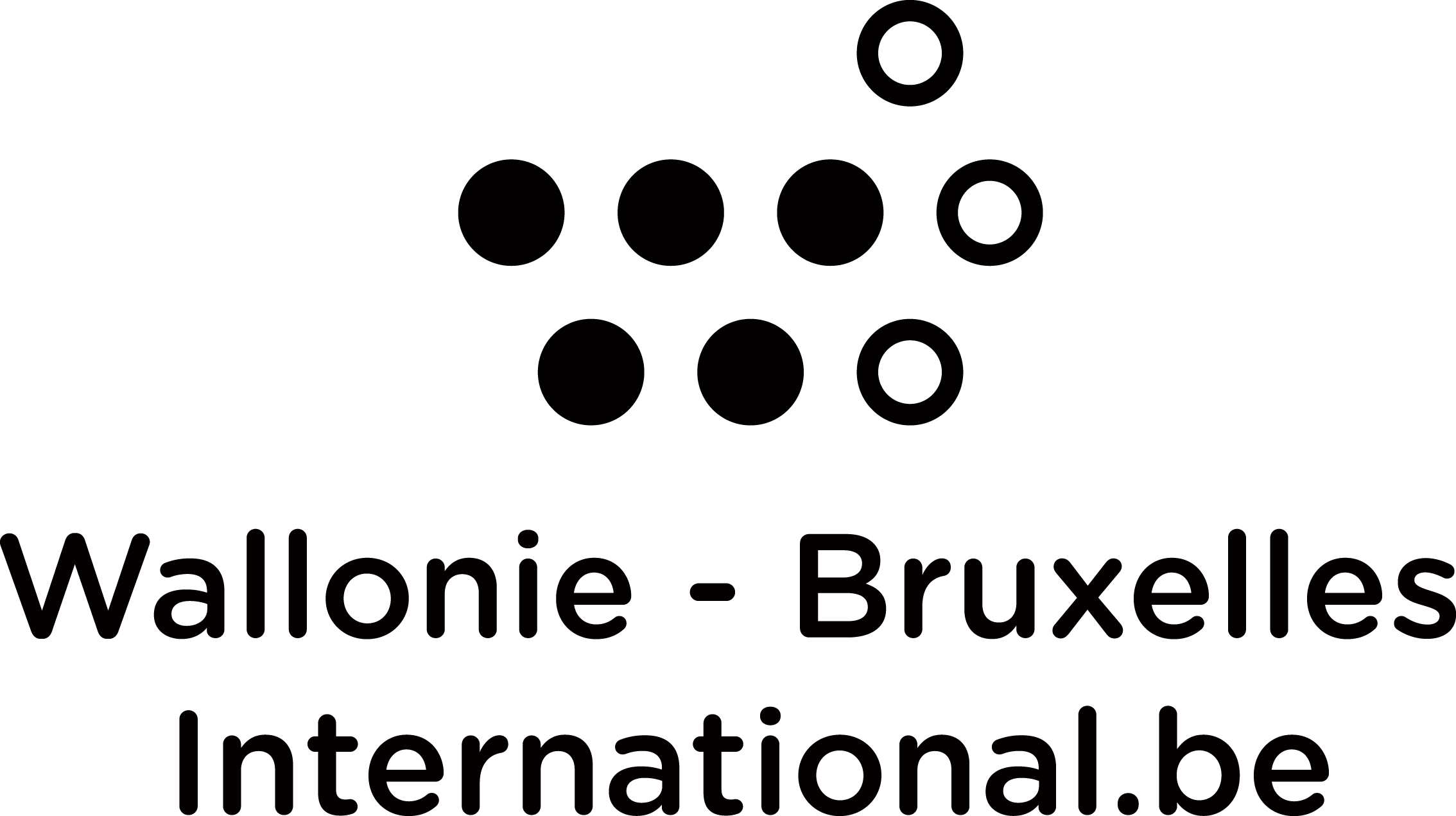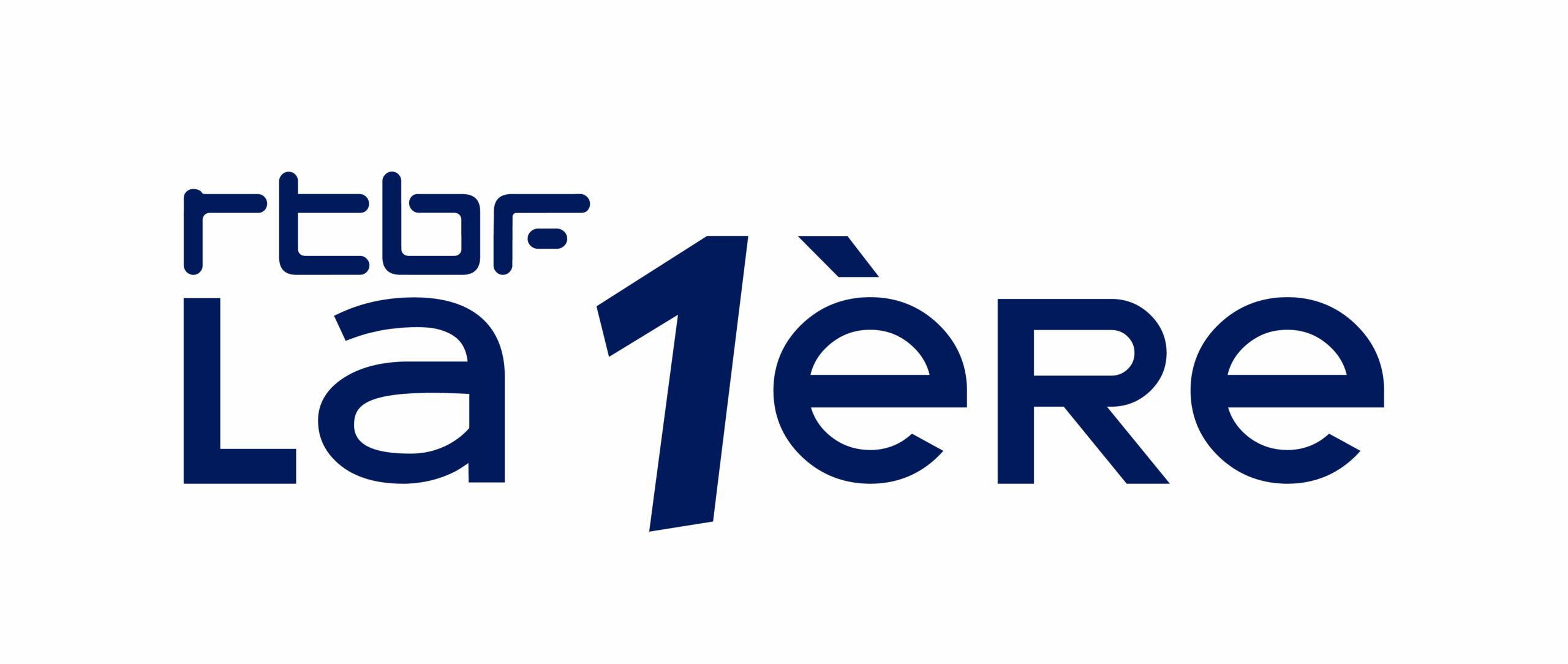Bernard Minier, ne nous délivrez pas du Mal !

En avril 2021, Bernard Minier est revenu, quelques mois à peine après « La Vallée », avec un nouveau roman intitulé « La Chasse » – lui aussi porteur de succès. Lu à travers le monde, dans plusieurs langues, les récits de l’auteur font toujours mouche. Et pour cause, Bernard Minier y aborde des sujets tantôt universels, tantôt tabous, interview du Mal à la Peur.
Dans Glacé, nous rencontrions pour la première fois votre personnage principal, Martin Servaz. Quels rapports entretenez-vous avec lui ?
Bernard Minier : C’est compliqué. Servaz, c’est un drôle d’emmerdeur ! Il est là tout le temps. Quand j’écris, je travaille sept jours sur sept. Donc, il est là sept jours sur sept! Entre Glacé écrit en 2008 et aujourd’hui, il a vieilli, il a mûri. Il a charge de famille, il est amoureux, bref il change. Mais la société change. Elle devient de plus en plus violente. Et mes lecteurs et lectrices changent. Ce qui plus intéressant encore c’est le rapport qu’ils entretiennent avec lui! Ils m’en parlent tout le temps. Comment va Servaz? Ils ne me demandent jamais comment je vais, moi ! Le personnage est suffisamment incarné et vivant pour que les lecteurs le perçoivent comme une présence familière. C’est une énorme récompense.
Vos deux derniers romans, La Vallée et La Chasse, sont sortis à quelques mois d’intervalle entre mai 2020 et avril 2021. Peut-on lire La Vallée comme une métaphore du confinement ?
Bernard Minier : Tout à fait. Et pourtant le livre a été écrit bien avant ! Il devait sortir avant le premier confinement. Mais la sortie a été retardée parce qu’en France les librairies étaient fermées. Dans La Vallée , la population d’une vallée se retrouve piégée par un éboulement et un assassin rôde. Les enfants ne peuvent plus aller à l’école, les parents sont au chômage technique, des groupes se révoltent (ils sont la métaphore de la crise des gilets jaunes de 2019). Je voulais montrer une population qui a peur de l’avenir et se révolte contre l’autorité. Quelques semaines plus tard… cela s’est vraiment passé !
Martin Servaz se retrouve enfermé dans cette vallée. Ne pourrait-on pas dire que, par son intégrité, sa détermination à trouver la vérité, il nous permet d’affronter le Mal ? N’est-ce pas pour cela que nous lui sommes si attachés ?
Bernard Minier : Oui, c’est le bouclier, c’est l’effet de catharsis. Il affronte pour nous, à notre place. Et, en même temps, il n’est pas un héros. C’est un anti-héros. Comme a dit un journaliste : c’est « un anti-héros technophobe ». Mais c’est un anti-héros parfois très héroïque.
Le Mal, c’est le fil rouge de vos livres !
Barnard Minier : C’est vrai, cette idée du Mal court à travers mes livres. Toutes les formes du Mal. À tel point que, dernièrement, j’ai appris que j’étais lu par un évêque bien connu ! J’ai commencé avec le personnage du Mal, du moins sa figure archétypale incarnée par un serial killer. Et, entre parenthèses, beaucoup de mes lecteurs l’adorent et attendent son retour ! Mais désormais ce qui m’intéresse c’est le Mal diffus, et plus encore le Mal déguisé en bien, le Mal qui croit faire le bien pour plus tard. Pour moi, c’est terrifiant parce que c’est le Mal qui donne bonne conscience.
En effet, le Mal change progressivement de visage entre vos premiers romans et La Vallée et La Chasse. Est-ce que La Chasse pourrait être considérée comme la chronique d’une déliquescence sociale annoncée ?
Bernard Minier : Oui, c’est la chronique d’un effondrement annoncé que l’on constate chaque jour un peu plus car les fondations de ce qui fait notre contrat social et moral, en France comme ailleurs, sont sapées chaque jour un peu plus. L’Etat, c’est une communauté organisée autour de règles qui en constituent le ciment et lui donnent du sens. Mais, en France, depuis quelques années, l’Etat s’effondre, son autorité est remise en question, les émeutes sont fréquentes. Les pompiers ou les médecins qui viennent porter secours se font agresser simplement parce qu’ils incarnent l’Etat. Parallèlement à cela, on assiste à une archipélisation de la société, à la formation de clans, de groupes qui ne communiquent plus entre eux. C’est une des questions de La Vallée autant que de La Chasse : la perte du dialogue. On est dans l’affrontement permanent. Les soignants des corps sont épuisés autant que les soignants du corps social, comme les flics. Ces gens qui sont en première ligne n’en peuvent plus parce qu’il y trop de crises en même temps : sociale, sanitaire, de l’autorité… On sent que ça tangue de tous les côtés.
Y avait-il une urgence à parler de cela ? A déplacer l’intérêt de Servaz, votre personnage central, du Mal pur vers le mal social ?
Bernard Minier : La Chasse est sans doute mon roman le plus politique. D’habitude, dans mes autres romans, j’écris des choses horribles pendant 400 pages, mais dès que le roman est fini, je passe à autre chose. Avec La Vallée et La Chasse, les questions demeurent après avoir refermé le livre. Certes, tous les romans tentent de montrer la complexité du réel. Mais nous sommes dans une période où cette complexité disparaît derrière le fake et la simplification à outrance,… Et derrière l’idéologie aussi. On se positionne de plus en plus par rapport à son idéologie. Or, l’idéologie se substitue toujours au réel, qu’elle transforme : une vision idéologique des choses modifie le réel.
L’idéologie se substitue toujours au réel, qu’elle transforme : une vision idéologique des choses modifie le réel.
Si vous regardez un tableau de Magritte ou de Delvaux en portant des lunettes de soleil, vous ne voyez pas le même tableau que celui qui a été peint. Et aujourd’hui, dès que nous tentons de nous écarter de la ligne idéologique que certains cherchent à nous imposer, nous sommes cloués au pilori sur les réseaux sociaux, lynchés, excommuniés. Or le roman, c’est exactement l’inverse. Comme le disait Milan Kundera dans l’Art du roman (1986) « l’esprit du roman est l’esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur : les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. » Et c’est vrai depuis Don Quichotte, qui croit tout savoir grâce à ses livres – aujourd’hui ce serait grâce aux réseaux sociaux – mais qui se fracasse contre les moulins à vent du réel et découvre qu’il y a mille vérités au lieu d’une. Dans La Chasse, j’ai aussi voulu montrer des points de vue différents : la mère de la victime, le général, les policiers, l’enseignante… Il faut que ces points de vue puissent continuer à dialoguer. Mais aujourd’hui, on refuse d’entendre des voix discordantes. Albert Jacquard disait « est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité ». Celui-là est enfermé dans ses certitudes et ne peut plus participer aux échanges. De plus en plus de gens se radicalisent, refusent le dialogue et veulent imposer aux autres leur vision du monde et de la société par la force, la contrainte, l’intimidation sur les réseaux sociaux ou par l’omniprésence dans les médias. Evidemment, avant tout je suis là pour raconter une histoire, pas pour ennuyer les lecteurs ou leur donner des leçons. Je me méfie beaucoup des donneurs de leçons qui prolifèrent, en particulier sur les plateaux de télé ! Or, on sait depuis Tartuffe que, là où il y a un donneur de leçon, en général il y a un imposteur. Moi, je me contente de poser des questions, celles que se posent mes lecteurs. Et je leur apporte aussi des petits éléments en plus, quelques clés supplémentaires parce que, pour écrire mon roman, je me suis renseigné, j’ai enquêté, j’ai rencontré des gens. Mais je ne prétends pas avoir les réponses.
C’est une des forces de La Chasse : l’information que vous donnez, on la sent vraie, totalement documentée, et en même temps, elle est un des soutiens de l’intrigue. Sans elle, le récit ne peut pas avancer.
Bernard Minier : Absolument. L’histoire est construite sur de l’information. Et qui plus est, dans La Chasse, certains faits « racontés » sont réels. Tout le reste est fiction. J’ai voulu ce mélange, cette ambiguïté. C’est comme une bonne pâte à crêpes : elle ne doit pas faire de grumeaux et elle doit être fluide! L’information ne doit pas faire de grumeaux dans le récit !
Vous aimez beaucoup Camus, pensez-vous qu’il y ait du Sisyphe dans Servaz, et dans sa lutte toujours recommencée comme le Mal ?
Bernard Minier : Je n’y avais jamais pensé mais je trouve que c’est une très belle image. Je suis tout à fait d’accord. J’ai eu deux maîtres à penser quand j’avais 20 ans, c’était Pasolini et Camus, deux hommes qui se sont rarement trompés sur les combats à mener, deux hommes de gauche mais qui se méfiaient comme de la peste (c’est le cas de le dire) des idéologies. Donc, cette image me plaît beaucoup.
Christine Defoin
Photo : Bruno Lévy